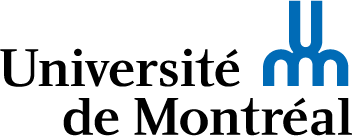Agressions sexuelles dans l’enfance: les séquelles psychologiques et physiques sont étroitement liées
- Salle de presse
Le 21 septembre 2020
- UdeMNouvelles
Une nouvelle étude démontre que les séquelles psychologiques laissées par une agression sexuelle chez les jeunes filles jouent un rôle dans l’apparition de problèmes de santé génitale et urinaire.
Ce constat est le résultat du projet de recherche mené par Pascale Vézina-Gagnon dans le cadre de son doctorat au Département de psychologie de l’Université de Montréal sous la direction de la professeure Isabelle Daigneault. Malgré son sujet difficile, l’étude a pour but de favoriser une meilleure intervention des professionnels de la santé afin que l’enfant puisse se rétablir autant sur le plan physique que sur le plan psychologique. Les résultats ont été publiés aujourd’hui dans la revue Health Psychology.
La genèse de l’étude
Ce n'est que récemment qu’il a été reconnu que les abus sexuels dans l'enfance peuvent avoir des conséquences à long terme sur la santé physique des survivants.
Une première étude conduite auprès de 1764 enfants et adolescents et parue en 2018 a révélé que les filles victimes d’une agression sexuelle corroborée recevaient 2,1 fois plus de diagnostics médicaux pour des problèmes de santé urinaire et 1,4 fois plus de diagnostics pour des problèmes de santé génitale que les filles de la population générale.
Une deuxième étude a ensuite été entreprise, toujours auprès des filles agressées sexuellement, afin de mieux comprendre pourquoi ou par quel mécanisme l’agression sexuelle menait à plus de problèmes de santé génito-urinaire chez ces dernières comparativement à leurs pairs de la population en général.
L’objectif de ce second projet de recherche était de mieux comprendre ces résultats en testant un modèle théorique selon lequel une plus grande détresse psychologique expliquerait en partie le lien entre un historique d’agression sexuelle durant l’enfance et l'émergence de problèmes physiques de nature génito-urinaire, comme des infections urinaires, des vaginites, des douleurs pendant les relations sexuelles ou lors des menstruations, entre autres problèmes.
«S’il y a une chose à retenir de cette deuxième étude, c’est que, lorsqu’on parle d’une agression sexuelle perpétrée sur une enfant, on ne peut pas seulement traiter les conséquences psychologiques ou physiques qui en découlent ou encore les traiter de façon complètement séparée, insiste Pascale Vézina-Gagnon. Nous sommes plus que jamais à une époque qui favorise l’interdisciplinarité et c’est ce que les omnipraticiens, pédiatres, urologues, gynécologues, psychologues et psychiatres doivent retenir de notre recherche afin que l’enfant puisse se rétablir de façon optimale.»
Les caractéristiques de l’étude
Cette étude est unique en ce sens que c'est la première fois que les problèmes de santé génito-urinaire et les problèmes de santé psychologique sont étudiés ensemble, auprès d’un aussi large échantillon de filles dont l’agression sexuelle a été corroborée et de son groupe de comparaison sur plus d’une décennie.
Les données médicales utilisées par les chercheurs ont été fournies par la Régie de l’assurance maladie du Québec et par le ministère de la Santé et des Services sociaux. L’étude a porté sur 661 filles, âgées de 1 à 17 ans, victimes d’une ou de plusieurs agressions sexuelles corroborées et 661 filles de la population générale (groupe de comparaison).
Les chercheurs ont pu accéder, de façon anonyme, aux diagnostics de santé génito-urinaire et psychologique reçus à la suite d’une consultation ou d’une hospitalisation entre les années 1996 et 2013. Plusieurs variables, comme le statut socioéconomique, le nombre d’années d’accès aux données médicales, les prédispositions individuelles à souffrir de problèmes de santé génito-urinaire avant l’agression sexuelle, ont été prises en compte.
Les agressions sexuelles commises sur les enfants peuvent comprendre les attouchements et les caresses, les pratiques sexuelles orales, la pénétration ou une tentative de pénétration, le voyeurisme, l’exhibitionnisme, l'incitation à des activités sexuelles et l'exploitation sexuelle (prostitution).
Les résultats les plus significatifs
«Les résultats révèlent que les filles qui avaient été agressées sexuellement étaient plus à risque de consulter un professionnel de la santé pour un plus grand nombre de catégories de troubles psychiatriques ‒ que ce soit des troubles anxieux, des troubles de l’humeur, la schizophrénie ou un abus de substance ‒ que les filles du groupe de comparaison. Cela a d’ailleurs permis de prédire qu’il y aurait davantage de consultations et d’hospitalisations pour des problèmes de santé urinaire et génitale dans les années suivant le signalement de l'agression sexuelle», explique Mme Vézina-Gagnon.
Les analyses ont aussi démontré que, après l’agression, plus les jeunes filles consultent ou sont hospitalisées pour un grand nombre de catégories de troubles psychiatriques (comorbidité psychiatrique), plus cela explique de manière importante qu’elles présentent par la suite davantage de problèmes de santé génitale (62 %) que de problèmes d’ordre urinaire (23 %) et que d'autres facteurs, non étudiés dans le cadre de cette recherche, pourraient expliquer cette différence.
«Des études supplémentaires seront nécessaires pour élucider cette différence et voir comment d’autres variables importantes auxquelles nous n’avons pas eu accès, comme la chronicité ou la gravité de l’abus sexuel, pourraient avoir des conséquences plus marquées sur la santé génito-urinaire», souligne la chercheuse en psychologie.
Comment expliquer ces résultats: hypervigilance ou évitement?
«Sur les plans émotionnel et comportemental, deux types d’hypothèses peuvent être avancées pour expliquer ces résultats. La première hypothèse est liée à une réponse d'hypervigilance: parmi les victimes d’agression sexuelle, celles qui présentent des problèmes de santé mentale plus nombreux, comme l'anxiété, la dépression ou le syndrome de stress post-traumatique, pourraient également devenir hypervigilantes ou plus à l’écoute à tout symptôme lié à leur santé génitale ou urinaire, ce qui les amènerait à consulter plus souvent un médecin.
«En revanche, la deuxième hypothèse concerne l'évitement comportemental, c’est-à-dire que les victimes attendraient avant de demander de l'aide et de consulter un médecin pour les troubles génito-urinaires ou évitent de le faire, avec le risque de détérioration ou de chronicisation de ces problèmes. En effet, les soins gynécologiques pourraient rappeler à la victime la situation d'abus – disparité de pouvoir entre le médecin et le patient, retrait des vêtements, vulnérabilité et douleur potentielle– et être particulièrement pénibles pour ces femmes», expose Mme Vézina-Gagnon.
Vers une prise en charge holistique
Les résultats de l’étude vont dans le même sens que la littérature scientifique dans le domaine de la psychologie de la santé et de la maltraitance et mettent une fois de plus en lumière l’importance de prendre en considération les liens entre le corps et l’esprit (approche holistique), entre la santé physique et la santé psychologique dans l’accompagnement des jeunes filles dans leur processus de rétablissement.
Ainsi, pour les filles ayant été victimes d'une agression sexuelle et présentant des problèmes de santé génito-urinaire, il serait nécessaire également d'évaluer leur niveau de détresse psychologique et de les diriger vers des ressources adéquates afin qu’on prenne soin de leur santé mentale. Des interventions précoces et adéquates pour réduire la détresse psychologique de ces jeunes filles pourraient possiblement prévenir la chronicisation et l'aggravation des problèmes de santé génito-urinaire chez celles-ci, recommandent les chercheuses ayant participé à l’étude.
À propos de cette étude
L’article «Childhood Sexual Abuse, Girls’ Genitourinary Diseases, and Psychiatric Comorbidity: A Matched-Cohort Study», par Pascale Vézina-Gagnon, Sophie Bergeron, Martine Hébert, Violaine Guérin et Isabelle Daigneault, est paru dans Health Psychology le 21 septembre 2020. doi: 10.1037/hea0000994.
Relations avec les médias
-
Julie Gazaille
Université de Montréal
Tél: 514 343-6796