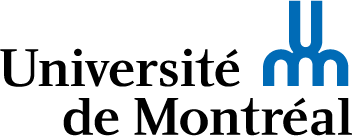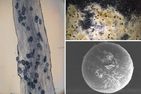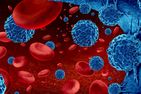Pourquoi les lémuriens sont-ils presque éteints et pourtant si diversifiés?
- Salle de presse
Le 7 janvier 2025
- UdeMNouvelles
Grâce au plus grand effort de recherche à ce jour, des anthropologues de l’UdeM ont séquencé les génomes de 162 lémuriens de l’île de Madagascar issus de 50 espèces et résolu un mystère évolutif.

Lémur catta («Lemur catta») et propithèque de Coquerel («Propithecus coquereli»)
Crédit : Lémur catta (Sannse at English Wikipedia, CC BY-SA 3.0 <http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/>, via Wikimedia Commons) et Sifaka de Coquerel (Charles J. Sharp, CC BY-SA 4.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0>, via Wikimedia Commons)Les lémuriens – ces petits primates aux grands yeux qui vivent dans les arbres de Madagascar, au large de la côte sud-est de l’Afrique – sont un mystère de l’évolution. Lorsque les premiers lémuriens sont apparus, il y a des dizaines de millions d’années, l’île comptait des écosystèmes extrêmement diversifiés allant des forêts tropicales humides à l’est aux étendues arides du sud-ouest.
Sans beaucoup d’autres mammifères concurrents, ces premiers lémuriens ont évolué vers un large éventail de formes, du microcèbe de la taille d’une tasse de thé au lémurien paresseux géant. Nombre de ces animaux présentent des niveaux de diversité génétique incroyablement élevés. Pourtant, paradoxalement, la quasi-totalité, soit 90 %, de la centaine d’espèces vivant sur l’île est menacée d’extinction.
Pour découvrir pourquoi, et peut-être résoudre ce mystère, des anthropologues et des biologistes de l’Université de Montréal et de l’Université Pompeu Fabra (UPF), en Espagne, ont adopté une approche génétique: ils ont séquencé les génomes de 162 lémuriens de Madagascar issus de 50 espèces, ce qui représente de loin le plus grand effort de séquençage de génomes de lémuriens à ce jour.
L’équipe internationale de recherche a ainsi révélé l’extraordinaire diversité de ces primates longtemps négligés et menacés, ce qui constitue une avancée majeure dans la compréhension de la manière dont la diversité génomique des primates a été influencée par des facteurs écologiques et anthropiques.
Sous la direction de Joseph Orkin, professeur adjoint à l’UdeM et chercheur principal au laboratoire multiomique sur l’évolution des primates des départements d’anthropologie et de sciences biologiques de l’Université, et de Tomàs Marquès Bonet, professeur-chercheur espagnol et chercheur principal à l’Institut de biologie évolutionniste de l’UPF, à Barcelone, l’équipe a découvert un certain nombre de ces facteurs.
Elle a notamment montré comment les variations écologiques, les fluctuations climatiques et l’activité humaine récente ont influencé la diversité génétique des lémuriens ainsi que leurs chances de survie à long terme.
Flux génétique généralisé
Publiées dans Nature Ecology & Evolution, les analyses de l’équipe mettent au jour un flux génétique généralisé entre les espèces de lémuriens depuis des centaines de milliers d’années.
«Parce que les changements climatiques ont relié périodiquement des habitats autrefois isolés, les lémuriens d’espèces et de populations différentes se sont croisés, partageant du matériel génétique qui a stimulé leur diversité globale, explique Joseph Orkin. En outre, les espèces les plus diversifiées semblent être celles dont les populations sont fragmentées dans plusieurs écosystèmes de l’île. Ce schéma d’isolement et de reconnexion semble construire et redistribuer la variation génétique sur l’ensemble de l’île.»
Il ajoute que «de nombreuses espèces de lémuriens présentent une diversité génomique très élevée, ce qui semble contrintuitif si l’on considère qu’un grand nombre d’entre elles sont gravement menacées d’extinction. Il est vraiment passionnant de voir comment l’écologie de Madagascar a contribué à façonner la diversité des lémuriens».
Les humains jouent un rôle majeur
Si Madagascar est un laboratoire pour la diversité des lémuriens, l’activité humaine récente joue un rôle déterminant dans l’effondrement de leurs populations. Les données montrent une correspondance frappante entre le début du déclin marqué des populations de lémuriens et l’expansion de la population humaine, la déforestation et les changements dans les pratiques de chasse.
Personne ne sait exactement à quel moment les humains sont arrivés à Madagascar, mais il est clair que leur nombre a commencé à augmenter il y a environ 1000 ans et que le paysage de l’île s’est mis à changer de manière importante dans les années 1700, note Joseph Orkin.
«Lorsque nous avons examiné les preuves génétiques du déclin des populations, nous avons constaté deux points d’inflexion constants, soit il y a environ 1000 ans et 300 ans. Il était vraiment frappant de constater un chevauchement aussi net entre le moment de l’expansion de la population humaine et le déclin des populations de lémuriens», mentionne-t-il.
Ces résultats ont des implications considérables pour les stratégies de conservation, fait-il remarquer. Si la fragmentation de l’habitat et la déforestation menacent les lémuriens en réduisant la taille des populations, elles coupent aussi les corridors naturels qui permettaient historiquement le flux génétique. Sans ces échanges génétiques, le risque de consanguinité augmente, ce qui met encore plus en péril des espèces déjà menacées.
«Cette situation n’est pas propre à Madagascar, souligne Joseph Orkin. L’expansion de la population humaine accélère la perte de biodiversité partout où nous regardons. Mais la morale de l’histoire est que les humains ne sont qu’une partie du monde naturel. Plus nous en apprendrons sur la façon dont la biodiversité est façonnée par les forces naturelles et humaines, plus nous aurons de chances de la protéger.»
À propos de cette étude
L’article «Ecological and anthropogenic effects on the genomic diversity of lemurs in Madagascar», par Joseph Orkin et ses collègues, a été publié le 27 décembre 2024 dans Nature Ecology & Evolution. Outre Tomàs Marquès Bonet, 33 scientifiques des États-Unis, du Royaume-Uni, d’Espagne, de France, du Danemark, d’Allemagne, du Vietnam, de Chine et de Madagascar sont signataires de l’article.
Relations avec les médias
-
Jeff Heinrich
Université de Montréal
Tél: 514 343-7593