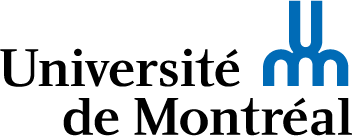L’avenir du français au Québec repose sur sa défense… et sur sa valorisation!
- Revue Les diplômés
Le 29 octobre 2021
- Martin LaSalle
Tous deux passionnés par la langue française, la terminologue et professeure Monique Cormier ainsi que l’auteur et professeur Benoît Melançon discutent de la situation du français au Québec.
Unis professionnellement par l’amour profond qu’ils éprouvent pour la langue française – ainsi que par leur passion commune pour le 18e siècle –, Monique Cormier et Benoît Melançon sont ambassadeurs de la langue de Molière tant au Québec que dans la francophonie. Diplômés de l’Université de Montréal, les deux professeurs échangent sur l’évolution et l’avenir du français au Québec.
Comment situez-vous le débat autour de la qualité de la langue française au Québec?
BENOÎT MELANÇON: Contrairement à ce qu’on dit, le hockey n’est pas le sport national du Québec : c’est la question de la langue qui l’est! La discussion linguistique autour de la qualité ou de la pureté du français est aussi vieille que le début de la colonie française en Amérique du Nord. En 1722, le jésuite Charlevoix disait des colons qu’ils parlaient un français plus pur qu’en France et qu’ils n’avaient pas d’accent. Mais cette prétendue pureté n’était pas définie, pas plus que la nature des accents…
MONIQUE CORMIER: Je suis d’accord avec Benoît: la discussion autour de la question de la langue a toujours été au cœur des préoccupations des Québécois et Québécoises. Mais je pense que, s’il est important de consolider le statut de la langue, il est tout aussi important de se préoccuper de la qualité de la langue. Ce qu’on ne fait pas suffisamment et qui exige des mesures appropriées!
BM: Il s’agit d’un problème de définition: le débat entourant la place du joual dans les années 60 est d’abord et avant tout une question d’emblème idéologique. Le joual n’existe pas, pas plus que le français dit «international». Ce sont des concepts non définis. Il est tout aussi incorrect de dire qu’on parle québécois: la «langue québécoise» n’existe pas. Au Québec, on parle français, avec des variations régionales.
Qu’avons-nous fait et que reste-t-il à faire pour promouvoir la langue française au Québec?
MC: Par exemple, la Commission des états généraux sur la situation et l’avenir de la langue française au Québec, présidée par Gérald Larose en 2000-2001, a retenu la recommandation que je lui ai présentée, selon laquelle toutes les universités québécoises devraient se doter d’une politique linguistique. Retenue également par le gouvernement, cette recommandation a donné lieu à une modification à la Charte de la langue française en 2002. Aujourd’hui, toutes les universités de la province ont une politique qui encadre en leur sein l’utilisation du français et des autres langues.
BM: De plus, la participation du Bureau de valorisation de la langue française et de la Francophonie de l’UdeM, consistant à faire un jumelage linguistique entre des étudiants et des commerçants du quartier Côte-des-Neiges, est un bel exemple qui a permis de renforcer l’usage du français au travail. Non seulement ce projet – amorcé en 2016 et mené sous votre gouverne, Monique! – a connu beaucoup de succès, mais il s’est poursuivi dans d’autres arrondissements montréalais ainsi qu’en banlieue, avec la Chambre de commerce du Montréal métropolitain.
MC: Le concours d’éloquence Délie ta langue! est une autre illustration des actions entreprises par le Bureau pour valoriser l’usage du français, en favorisant dans la communauté étudiante le développement de compétences en art oratoire dans la prise de parole en public. Je crois beaucoup à ce concours, auquel l’Université du Québec à Rimouski a participé cette année, et je rêve qu’il s’étende un jour à l’ensemble des universités québécoises.
Ce qu’il faut retenir de ces exemples est que notre principal défi au chapitre de la langue française est sa valorisation, et pas uniquement sa défense. La question linguistique progresse au Québec, entre autres avec le projet de loi no 96 pour protéger le statut du français dans certains cas, mais la valorisation est un mode positif, qui favorise l’offensive, et c’est là tout un champ à exploiter qu’ouvre actuellement la question linguistique.
BM: L’adoption de la Charte de la langue française, en 1977, a une dimension historique: l’époque commandait une défense de la langue, mais cette stratégie ne suffit plus aujourd’hui, surtout auprès des jeunes. Le discours alarmiste sur l’état de la langue chez les jeunes est non seulement contre-productif, mais il ne repose sur aucune donnée valable. On n’est pas devant une catastrophe linguistique, on est dans le jugement de valeur: plusieurs étudiants s’expriment tout aussi bien, sinon mieux, que ceux d’avant. Comme toujours, il y en a des bons et des moins bons.
MC: Il y a quand même certains points inquiétants, comme les résultats mitigés des futurs enseignantes et enseignants au test de certification en français écrit pour l’enseignement. Je pense aussi à la fragilité du français, langue des sciences et des techniques, dans le domaine de la recherche universitaire de même que dans les milieux de travail. Nous avons besoin de mesures législatives pour protéger la langue et assurer son maintien, mais nous avons aussi besoin d’innovations pour valoriser son usage afin que les jeunes ressentent de la fierté à parler français et à travailler en français.
C’est pourquoi je ne vois pas d’un œil favorable que les finissants de cinquième secondaire puissent fréquenter un cégep de langue anglaise. Il faut pouvoir vivre au quotidien en français, y compris dans le milieu du travail. En suivant une formation supérieure en anglais, le risque est grand qu’on ne connaisse pas le vocabulaire propre à son domaine de spécialisation et qu’on utilise spontanément le vocabulaire de ses études, l’anglais en l’occurrence. Sans parler du choix d’une université autre que de langue française par la suite…
BM: Je n’adhère pas spontanément à l’interdiction d’aller au cégep en anglais, mais il va de soi que la langue commune du travail est fondamentale. On accorde trop d’importance à la langue parlée à la maison et à la langue maternelle. L’indicateur de l’évolution de l’usage du français qui doit prévaloir est la langue parlée au travail. Et c’est une question qui concerne essentiellement la grande région de Montréal. Du reste, être unilingue francophone n’est pas souhaitable, il faut s’ouvrir aux autres langues.
MC: Sur ce point, nous sommes tout à fait d’accord: il ne faut pas «moins de langues», mais «plus de langues»!
Monique Cormier
Titulaire d’une maîtrise en traduction de l’Université de Montréal et d’un doctorat en traduction de l’Université Sorbonne Nouvelle-Paris 3, Monique Cormier est professeure titulaire au Département de linguistique et de traduction depuis 1988. Active dans divers conseils d’administration, elle a été présidente de l’Ordre des traducteurs, terminologues et interprètes agréés du Québec. Directrice du Bureau de valorisation de la langue française et de la Francophonie, elle devient en 2015 vice-rectrice associée à la langue française et à la Francophonie, postes qu’elle a occupés jusqu’en mai.
Élue à la Société royale du Canada, Monique Cormier a reçu notamment les prix Georges-Émile-Lapalme et Camille-Laurin ainsi que les grades de chevalière de l’Ordre national du Québec et d’officier de l’Ordre des arts et des lettres de la République française.
Benoît Melançon
Docteur en études françaises de l’Université de Montréal depuis 1992, Benoît Melançon y est professeur titulaire au Département des littératures de langue française. Essayiste, éditeur et blogueur, il est l’auteur entre autres de Langue de puck: abécédaire du hockey (2014), Le niveau baisse! (et autres idées reçues sur la langue) (2015), L’oreille tendue (2016) et Nos Lumières (2020).
Benoît Melançon travaille actuellement sur les questions de langue au Québec et sur les rapports entre culture et sport.
Membre de la Société royale du Canada, il a reçu de nombreux prix et distinctions, dont le prix Acfas André-Laurendeau pour les sciences humaines et le prix Georges-Émile-Lapalme, la plus haute distinction du gouvernement du Québec en matière de rayonnement et de qualité de la langue française.
Écriture inclusive: une formation en ligne offerte gratuitement
Une formation en ligne gratuite et ouverte à tous et toutes sur l’écriture inclusive est offerte gratuitement par l’Université de Montréal depuis juin. Déjà, plus de 1700 personnes s’y sont inscrites ou l’ont suivie.
Cette formation de 50 minutes, soutenue financièrement par l’Office québécois de la langue française, s’ajoute à Inclusivement: le guide d’écriture pour toutes et tous, qui fait partie des outils proposés par le Bureau de valorisation de la langue française et de la Francophonie de l’UdeM en matière d’écriture inclusive.
Destinée à des contextes de communication professionnelle, l’écriture inclusive «n’est pas une norme, mais bien une manière d’écrire qui peut tenir compte de toutes les personnes auxquelles un texte s’adresse, qu’il s’agisse d’un homme, d’une femme ou d’une personne qui ne s’identifie pas à un genre en particulier», explique Monique Cormier, qui a participé à la mise sur pied de la formation en ligne.
Le grand principe enseigné dans cette formation est de concevoir dès le départ ses textes dans un style inclusif sans perdre en clarté. «Par exemple, au lieu de parler des auditeurs, on peut parler de l’auditoire, illustre Mme Cormier. Il faut notamment penser à choisir des mots épicènes, c’est-à-dire qui ne précisent pas un genre et qui évitent d’employer des doublets. S’inscrivant dans le mouvement social d’équité, de diversité et d’inclusion, cette formation est un très bon départ pour s’habituer à utiliser l’écriture inclusive au quotidien.»