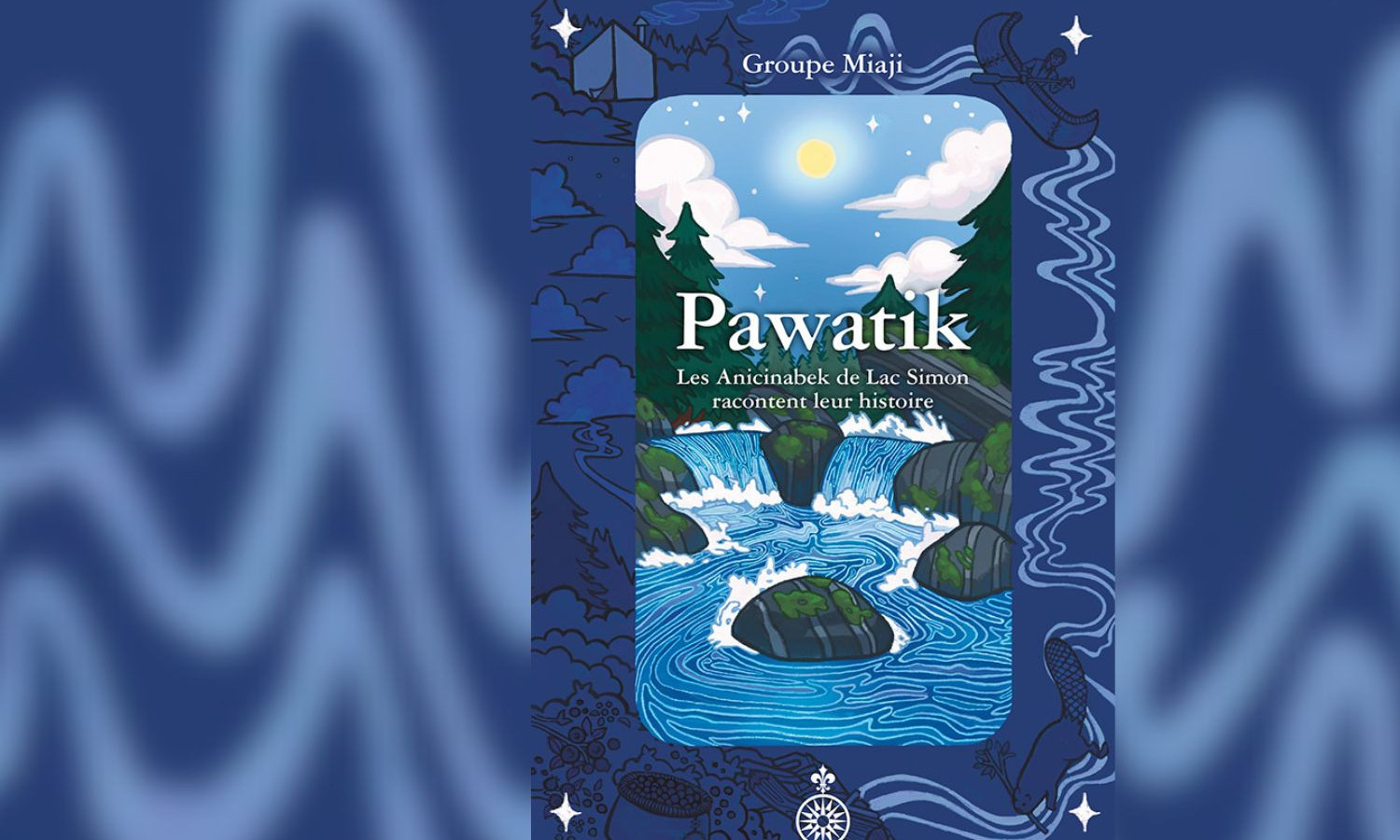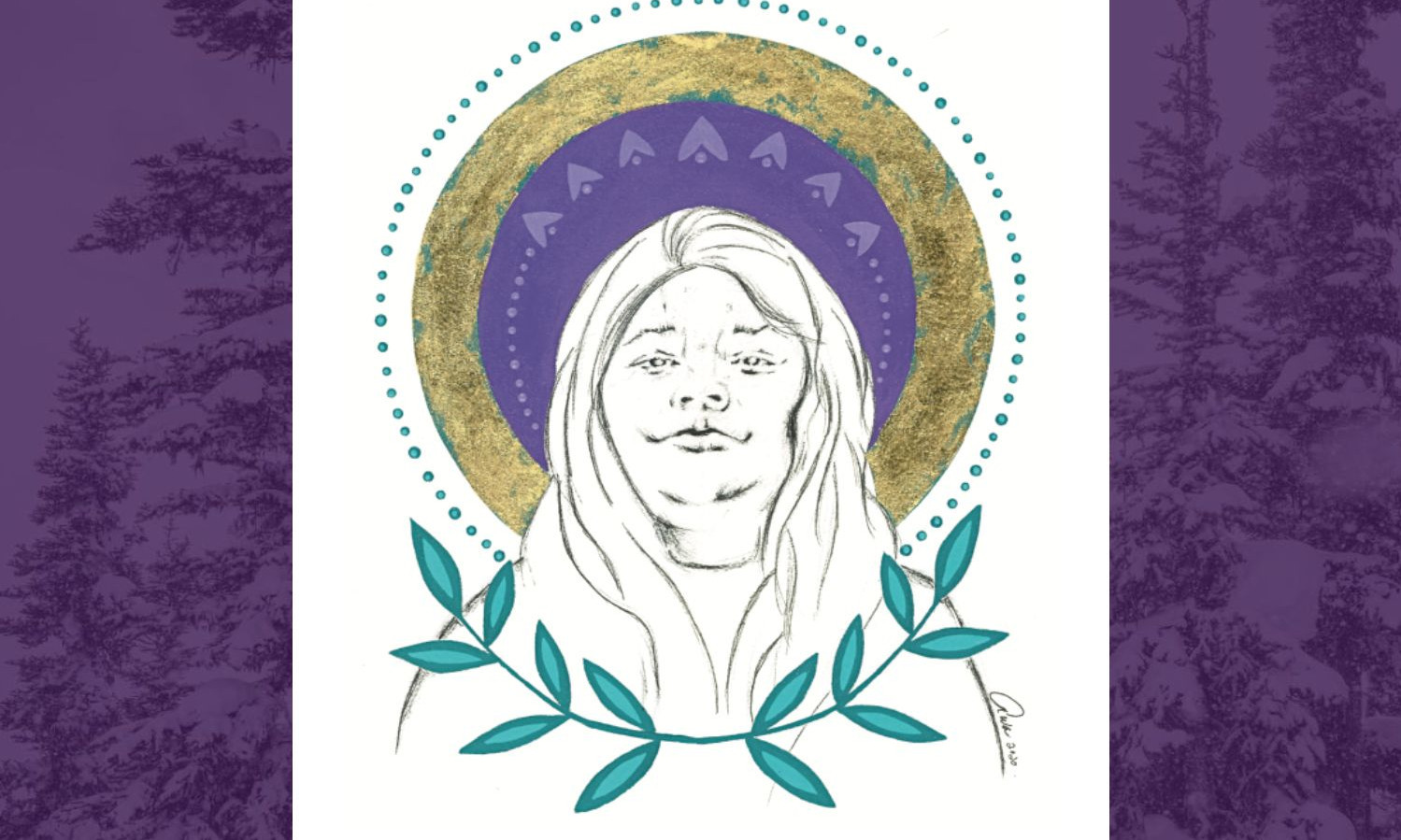L'esclavage des enfants autochtones en Nouvelle-France

Dans la série
Les Premiers Peuples à l'UdeM Article 11 / 16
Des enfants âgés de seulement quelques années, arrachés à leur famille, transportés sur de longues distances et réduits à l’état de propriété: telle est la face sombre, encore largement méconnue, de l’histoire de la Nouvelle-France – y compris à Montréal.
Longtemps ignoré par les chercheurs, l’esclavage dans la vallée laurentienne est resté un angle mort de l’historiographie. La professeure d’histoire de l’Université de Montréal Dominique Deslandres sort de l’oubli ces pages funestes du passé dans une étude publiée dans la Revue d’histoire de la Nouvelle-France ainsi que dans un article paru dans le dernier numéro des Cahiers des dix.
L’esclavage, un phénomène très répandu en Nouvelle-France

Si l’esclavage n’était pas inconnu des sociétés autochtones avant l’arrivée des Européens, la forme introduite par les colons français et anglais suivait la règle romaine du partus sequitur ventrem: l’enfant d’une mère esclave naissait lui aussi esclave. «En revanche, chez les Autochtones, le statut d’esclave n’est pas transmis à la génération suivante. Le statut suit la personne et non sa descendance. Le statut de l’esclave peut aussi changer, celui-ci pouvant par exemple remplacer quelqu’un qui a été tué dans la tribu», explique Dominique Deslandres.
Les estimations pionnières de Marcel Trudel dans les années 1960 faisaient état d’environ 4000 esclaves en Nouvelle-France, majoritairement autochtones. «Mais des recherches plus récentes montrent que ce chiffre pourrait atteindre près de 10 000 entre 1632 et la Conquête anglaise», poursuit l’historienne.
Ce qui ressort de manière terrifiante de sa recherche est la jeunesse extrême d'une large part de la population asservie, particulièrement chez les Autochtones. Entre 1632 et 1760, sur les 1574 esclaves dont l'âge est connu, 734 avaient moins de 12 ans lors de leur dernière mention dans les registres. Dans le seul gouvernement de Montréal et pour la même période, sur 947 esclaves dont l'âge est connu, 430 Autochtones et 49 Afrodescendants avaient moins de 12 ans.
Ces enfants, souvent désignés par le terme générique de panis ou panise, n’avaient parfois qu’un prénom. S’ils avaient un nom de famille, c’était celui de leur maître. Cette anonymisation participait, selon Dominique Deslandres, à la «mort sociale qu’impose l’esclavage».
Des chiffres glaçants
«Les chiffres terrifiants, issus des travaux en démographie historique de Cathie-Anne Dupuis, révèlent que, entre 1632 et 1759, la moitié des esclaves masculins autochtones meurent avant l’âge de 17 ans et que, entre la Conquête anglaise et l’abolition de l’esclavage en 1834, cet âge médian au décès tombe à 11 ans. Celui des femmes esclaves autochtones passe de 21 ans pendant le Régime français à 13 ans sous le Régime anglais», mentionne l’historienne.
Elle souligne avec effroi que ces décès ne coïncident pas toujours avec les grandes épidémies, ce qui soulève la question des mauvais traitements subis par les esclaves.
Pourquoi tant d’enfants esclaves autochtones?
Plusieurs facteurs expliquent cet afflux de très jeunes esclaves. La demande de main-d’œuvre était forte dans la colonie pour accomplir des tâches pénibles, qu’il s’agisse de ramer, de travaux dans les champs ou de travaux domestiques lorsque les femmes de colons étaient elles-mêmes débordées avec des grossesses multiples. L’importation d’esclaves africains restait limitée. Les alliés autochtones des Français, lors de raids contre leurs ennemis, capturaient et vendaient des prisonniers, souvent des enfants. Ces captifs, venus d’autres nations que celles alliées aux Français, devenaient le principal réservoir d’esclaves.
Le coût jouait aussi: un esclave autochtone coûtait nettement moins cher qu’un Afrodescendant. Mais au-delà du prix, les colons estimaient qu’il était plus facile de «faire à sa main» un enfant. «Il est plus aisé de cultiver la loyauté d’un être arraché très jeune à sa famille, coupé de ses liens significatifs», remarque Dominique Deslandres. En d’autres termes, briser les attaches culturelles et familiales d’un enfant le rendait plus docile, moins susceptible de fuir ou de résister.
L’attrait pour les enfants esclaves s’explique aussi par le contexte familial patriarcal et les tensions autour de l’héritage. Posséder et élever un enfant esclave permettait aux parents vieillissants de s’assurer une main-d’œuvre fidèle pour leurs vieux jours. «Acheter et fidéliser, en l’élevant, un enfant esclave permettait ainsi de se ménager une retraite paisible à l’abri de l’avidité des héritiers», suggère l’historienne.
L’effroyable réalité du quotidien
L’image d’un esclavage «doux» ou de l’esclave «membre de la famille», véhiculée par Marcel Trudel, est largement remise en question. Dominique Deslandres est catégorique: «Je ne considère pas que c’est un esclavage doux quand on vous prive de votre liberté», dit-elle.
Les enfants esclaves vivaient une «servitude patriarcale rigide». Placés tout en bas de la hiérarchie domestique, ils appartenaient à leur maître ou maîtresse et leur devaient une obéissance totale. Leur travail commençait très tôt: tâches domestiques, agricoles ou liées aux animaux, semblables à celles des enfants placés en service. À la différence près que l’engagé retrouvait sa liberté après son contrat. C’était souvent la maîtresse de maison qui gérait ce «cheptel enfantin». Si l’on prenait soin d’un esclave malade en l’envoyant à l’Hôtel-Dieu, c’était avant tout pour préserver un bien coûteux, «comme aujourd’hui on amène sa voiture au garage pour l’entretien», illustre Dominique Deslandres.
Puisqu’ils étaient considérés comme des biens meubles, elle ajoute qu’«à peu près toutes les familles» avaient potentiellement accès à cette main-d’œuvre servile, soit en possédant, soit en louant les services d’un esclave pour quelques heures, «de la même manière qu’on peut louer une auto pour la journée».
En cas de désobéissance, les punitions pouvaient être très sévères, surtout à la fin du Régime français, une période marquée par la peur des révoltes d’esclaves comme celles des Antilles ou de la Louisiane. «Les punitions d’esclaves vont être extrêmement sévères pour tout ce qui est atteinte à la personne», mentionne la professeure, citant l’exemple tragique d’une esclave pendue pour avoir, sans le vouloir, agressé sa maîtresse.
Des histoires qui émergent des archives

Les recherches de Dominique Deslandres, en collaboration avec son équipe, prennent appui sur le logiciel Transkribus, qui permet d’interroger des milliers de documents anciens et de les transcrire grâce à l’intelligence artificielle.
«Simplement en cherchant les mots panis et panise, j’ai pu trouver des centaines d’archives auxquelles je n’aurais jamais pensé», raconte-t-elle. Cela permet de reconstituer des parcours de vie individuels, trop longtemps réduits à une ligne dans un registre.
Parmi ces destins, celui de François, un jeune esclave autochtone, a retenu l’attention de l’historienne. Arrivé dans la colonie vers l’âge de 6 ou 7 ans, il est émancipé à 17 ans et reçoit une terre. Mais la liberté reste fragile: accablé de dettes, François finit par léguer tous ses biens à son ancien maître et redevient esclave. L’histoire de François résonne profondément chez Dominique Deslandres, qui a découvert qu’une de ses aïeules avait épousé un esclave autochtone venu enfant dans la colonie. Enfin, au cours de ses marches dans Montréal, elle suit les traces de François: «Son univers rejoint le mien, mais à plusieurs siècles de distance. Je marche dans ses pas: il vivait sur la rue Saint-Paul, j’y passe quand je me rends aux Archives nationales, j’habite près des terres des prudhommes où il a travaillé et je peins à proximité de la terre où, une fois affranchi, il avait obtenu une concession», décrit-elle.