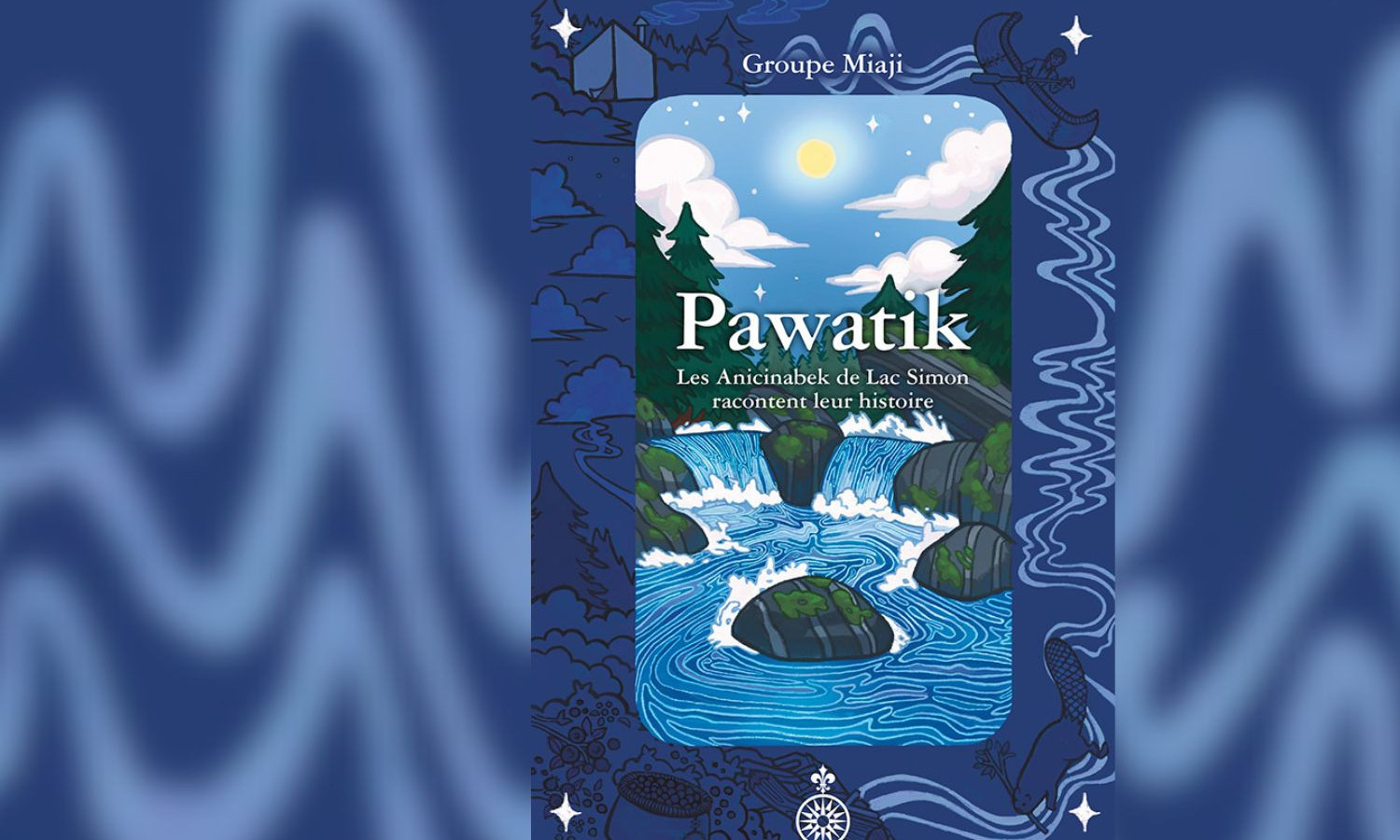Cinq ans après Joyce: quelle réconciliation entrevoir avec les institutions publiques?

Dans la série
Les Premiers Peuples à l'UdeM Article 13 / 16
Le décès de Joyce Echaquan survenu le 28 septembre 2020 a créé une onde de choc dans toute la province et au-delà. Le Principe de Joyce est né par la suite et vise à garantir aux Autochtones le droit à un accès sans discrimination aux services sociaux et de santé. Ce principe se fonde directement sur l’article 24 de la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones et est lié au concept de sécurité culturelle, introduit pour transformer les services de santé et les services sociaux afin que les usagers autochtones y aient accès en toute équité.

Pour souligner le cinquième anniversaire de la mort de Joyce Echaquan et pour lui rendre hommage, un colloque organisé conjointement par la professeure de droit de l’Université de Montréal Karine Millaire et le Bureau du Principe de Joyce du Conseil des Atikamekw de Manawan aura lieu les 27 et 28 septembre à Trois-Rivières. L’évènement réunira 150 personnes parmi lesquelles des spécialistes de diverses disciplines s’intéressant au Principe de Joyce et à la sécurité culturelle, des porteurs de savoirs autochtones, des professionnels de la santé, des représentants de différents ordres professionnels en santé, des décideurs publics ainsi que des organisations autochtones et des usagers issus des Premières Nations. Le volet scientifique du colloque a été proposé par Karine Millaire, experte en droit constitutionnel, droits et libertés de la personne et droit autochtone, qui a obtenu des subventions totalisant plus de 80 000 $ du Conseil de recherches en sciences humaines du Canada, du Fonds d’études notariales de la Chambre des notaires du Québec et de la Commission du droit du Canada. UdeMNouvelles l’a rencontrée. Trois questions à Karine Millaire pour faire le bilan des dernières années en ce qui concerne, entre autres, la sécurité culturelle.
Il a fallu la mort d’une femme autochtone insultée par du personnel hospitalier pour faire avancer la réflexion et adopter le Principe de Joyce. Qu'est-ce que cette déclaration a permis de changer dans les établissements de santé et de services sociaux?
La mort de Joyce Echaquan a effectivement permis une prise de conscience importante. Parce qu’elle s’est filmée, le public a pu voir et entendre à quel point le traitement réservé aux Autochtones au sein du système de santé peut être méprisant et raciste. La coroner Géhane Kamel a conclu que le racisme antiautochtone subi par Joyce Echaquan a bel et bien contribué à son décès. Joyce est ainsi devenue le visage de la lutte pour enrayer ce racisme et assurer la sécurité culturelle.
Depuis, les milieux professionnels et universitaires, entre autres, ont agi concrètement pour changer les pratiques. Des formations à l’intention du personnel soignant ont été mises sur pied. Ce processus nécessite d’abord de prendre acte du déséquilibre de pouvoirs résultant du colonialisme et de reconnaître que le racisme et la discrimination systémique existent. Ainsi, on relève de nombreux cas où des erreurs de diagnostic ont été commises parce que le personnel soignant a, en raison de préjugés, erronément associé la douleur ou l’état d’une personne autochtone à la consommation d’alcool. Nous savons aussi que souvent le consentement n’a pas été respecté, par exemple dans le cas des stérilisations forcées récemment mises en lumière. De cette reconnaissance des répercussions du racisme peuvent découler une posture d’humilité culturelle et un cheminement pour transformer les relations avec les Autochtones au sein du système de santé. Au Québec, les ordres professionnels des infirmières et infirmiers et des médecins se sont engagés dans cette voie.
Comment la recherche universitaire, celle effectuée par vous et par vos collègues d’autres disciplines, peut-elle se mettre au service des besoins des communautés autochtones?
La recherche peut soutenir le Principe de Joyce de plusieurs façons, notamment en levant le voile sur les conséquences très concrètes du racisme systémique sur les patients autochtones. Ensuite, des solutions et des formations peuvent être élaborées, dont des normes et des standards à respecter.
D’un point de vue juridique, la recherche doit contribuer à faire du Principe de Joyce et du concept de sécurité culturelle des «droits» exigeant des transformations profondes dans les institutions publiques. Un peu comme le concept de harcèlement à une autre époque, la science a permis de mettre en lumière sa «réalité» et le domaine juridique a permis de reconnaître le «droit» à ne pas subir de harcèlement psychologique ou sexuel. C’est ainsi que les lois ont été changées et que des politiques publiques ont été mises en place.
De plus, la mobilisation des connaissances est essentielle pour faire en sorte que les usagers autochtones connaissent leurs droits et puissent agir en cas de violation. C’est pourquoi je travaille en partenariat avec le Bureau du Principe de Joyce sur un guide pratique sur les droits à la sécurité culturelle et au Principe de Joyce. L’objectif est de soutenir une reprise de pouvoir des Autochtones par la connaissance et l’action.
Si nous nous tournons vers l’avenir, que reste-t-il à faire en matière de sécurité culturelle?
Même si les ordres professionnels et plusieurs intervenants ont reconnu le Principe de Joyce, le gouvernement du Québec nie toujours l’existence du racisme systémique. Ce déni n’est pas banal. Comme pour la lutte contre le harcèlement par exemple, les recherches démontrent qu’il est nécessaire de reconnaître pleinement l’existence d’un problème afin de pouvoir l’enrayer.
Il reste donc beaucoup à faire en matière de sécurité culturelle, même si des pas importants ont été accomplis. Nous devons continuer de nous pencher sur la réalité des usagers autochtones au sein du système de santé et de la décrire avec exactitude. Nous devons continuer de concevoir de meilleurs programmes de formation et d’assurer leur mise en œuvre. Nous devons élaborer des outils précis d’évaluation des résultats ainsi que des politiques contraignantes exigeant des redditions de comptes. Nous devons plus largement instaurer des approches et politiques considérant la sécurité culturelle au-delà du milieu de la santé pour englober aussi les milieux de la justice, de l’éducation et des relations de travail par exemple.