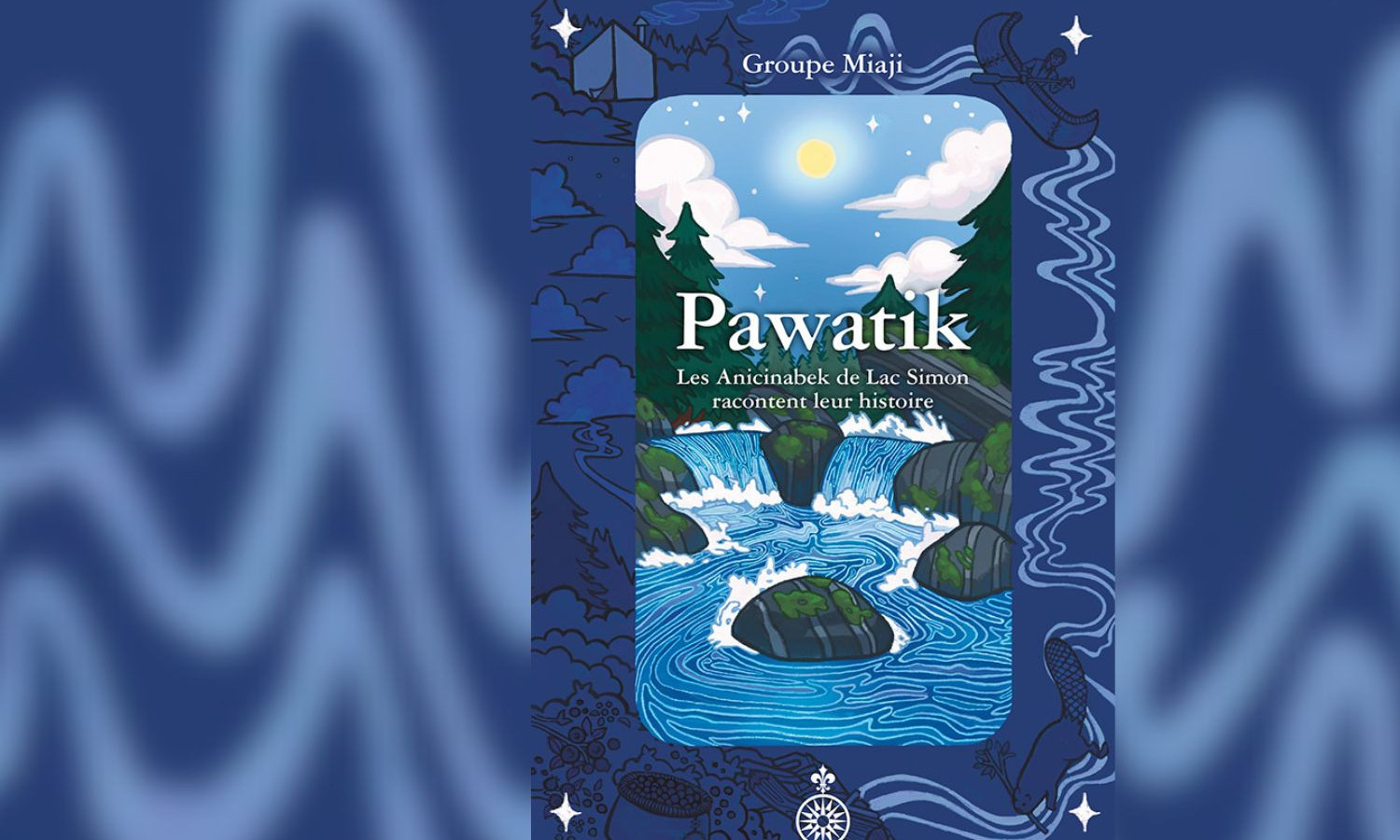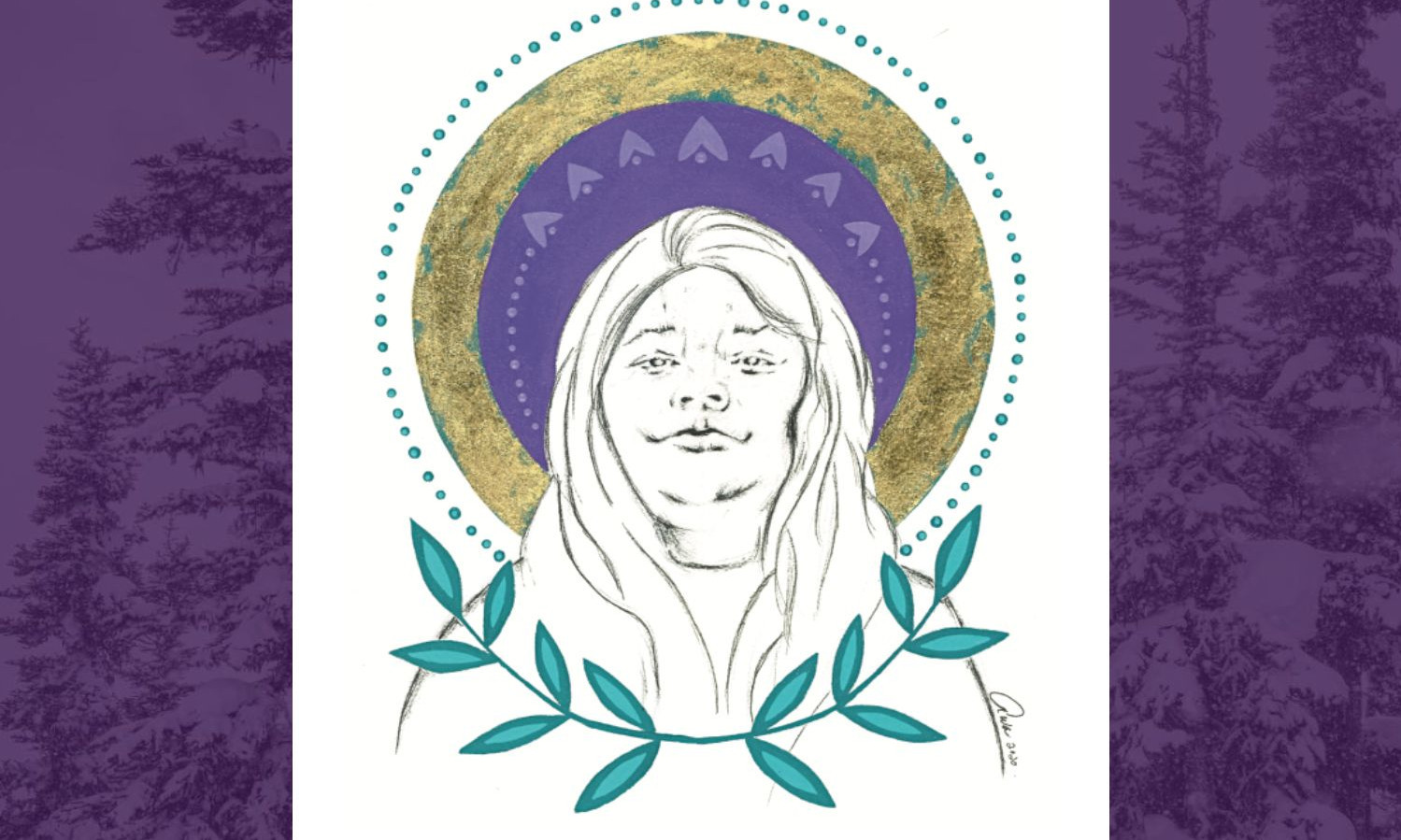Enseigner l’innu-aimun

Dans la série
Les Premiers Peuples à l'UdeM Article 12 / 16
«J’avais vu l’annonce du Centre de langues, mais je n’étais pas certaine que ça m’intéressait», raconte Yvette Mollen. L’Université de Montréal cherche alors à mettre sa pierre à l’édifice de la valorisation et de la diffusion des langues autochtones – le recteur Daniel Jutras porte par ailleurs un intérêt tout particulier à l’innu, prononçant à l’occasion un discours dans cette langue.
Yvette Mollen, suivant les traces de sa mère qui donne des cours d’innu dans sa communauté, compte déjà plusieurs années d’expérience en enseignement. À l’époque, elle donne des cours (grammaire et orthographe de la langue) à l’Université du Québec à Chicoutimi comme chargée de cours et à des membres de la communauté innue, jeunes comme moins jeunes.
Elle décide tout de même de relever le défi, créant ainsi le premier cours d’innu destiné aux non-locuteurs de la langue innue en milieu universitaire au monde. Ces nouveaux étudiants et étudiantes sont adultes, et pour la plupart non locuteurs, et ont eu peu de contacts avec l’innu-aimun. «Ils ne sont pas du tout familiers avec la langue et parfois ne l’ont jamais entendue!» remarque-t-elle. Depuis, quatre cours ont été mis sur pied: le cours de niveau 1 est donné toutes les sessions et les cours 2, 3 et 4 sont en alternance.
Tout à faire

Yvette Mollen s’est donc attelée à concevoir sa méthode et ses outils d’enseignement. Heureusement, plusieurs ouvrages de référence existent. «Le Centre de langues a d’ailleurs choisi l’innu-aimun parce que c’est une des langues autochtones les plus documentées. Et moi, j’ai participé à ça», évoque-t-elle. En effet, que ce soit à l’Institut Tshakapesh ou à travers sa participation à des projets de recherche avec des linguistes de diverses universités (Marguerite MacKenzie, Anne-Marie Baraby, Lynn Drapeau, Marie-Odile Junker), Yvette Mollen a pris part (et continue de le faire) au travail sur le dictionnaire innu-français, comme sur la standardisation de la langue innue.
Malgré tout, «tout était à inventer!» se rappelle-t-elle. Au cœur de ses cours, la compréhension de la structure de la langue. «Je peux bien faire répéter les étudiantes et étudiants comme des perroquets, mais moi, quand j’apprends une autre langue, je veux comprendre sa structure», souligne-t-elle. Durant les cours, les groupes apprennent le vocabulaire, l’orthographe, la phonologie et la structure de l’innu-aimun.
Pour faciliter l’apprentissage, elle a l’idée de concevoir de courtes conversations, écrites, qu’elle enregistre également avec des locuteurs natifs, pour bien faire entendre la prononciation. «Un mot isolé veut dire quelque chose, mais le sens change lorsqu’il est combiné avec un autre mot», explique Yvette Mollen.
Et cela fonctionne: «Je trouve ça intéressant quand les étudiants et étudiantes remarquent mes erreurs lorsque j’écris au tableau. Ils comprennent que l’orthographe est importante», estime-t-elle.
Des retombées jusque dans les communautés
Enseigner l’innu-aimun à des non-Autochtones dans la métropole n’assurera pas le maintien de l’innu dans les communautés. Mais Yvette Mollen ne travaille pas en vain. «Je participe à la réconciliation, à ce que les Autochtones soient connus et reconnus, toujours en défaisant les préjugés», souligne-t-elle.
Certains Innus suivent ses cours pour renouer avec leur héritage; des allochtones travaillant dans les communautés viennent chercher des connaissances de base pour mieux comprendre la culture.
Recruter la relève pour donner les cours est par ailleurs difficile. «La relève, j’essaie de la fabriquer! Je ne veux pas arracher les professeurs aux communautés, elles en ont davantage besoin là-bas qu’ici», croit-elle. Elle a ainsi formé sa fille Gaëlle, qui est aujourd’hui chargée de cours au Centre de langues et qui a donné à plusieurs reprises le cours de niveau 1.
À travers la langue, Yvette Mollen fait aussi la promotion de la culture innue. «On ne peut pas séparer la langue et la culture. Je partage les connaissances, je parle de la culture. Ça ouvre les étudiants et les étudiantes au monde», indique-t-elle. La toute première école d’été a été offerte l’été dernier, prenant la forme d’une semaine dans la communauté d’origine d’Yvette Mollen, Ekuanishit, sur la Côte-Nord. Ce cours immersif sera de retour à l’été 2026.
Cette expérience a permis aux participantes et aux participants de mettre à l’épreuve leurs connaissances, mais aussi de faire parler les enfants dans la communauté, ce qui lui tient à cœur. «Les enfants étaient curieux et venaient les voir; la meilleure façon d’apprendre une langue, c’est de parler avec des enfants. Ils ne jugent pas!» dit Yvette Mollen.
Et pour les jeunes Innus, voir un allochtone parler la langue de leurs parents et de leurs grands-parents a un effet positif. «Ils voient que leur langue est importante. Et c’est ça qui est essentiel. Je ne veux pas que l’innu meure, je veux qu’il garde sa place, pour toujours», conclut-elle.